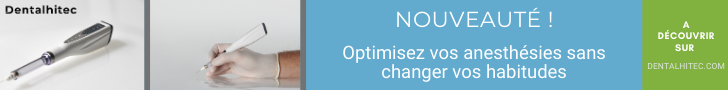Le Grand Entretien avec Chloé Bertolus

JANVIER 2021
Le Professeur Chloé Bertolus est cheffe de service de chirurgie maxillo-faciale à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière.
Un patient particulier l’a fait connaître du grand public…
« La médecine
c’est le choix de l’angoisse et l’angoisse du choix »
Vous êtes cheffe de service de chirurgie maxillo-faciale à la Pitié Salpêtrière.
Le récit autobiographique de Philippe Lançon, Le lambeau*, vous a révélé au grand public.
Une certaine Chloé y réalise une chirurgie du visage du journaliste gravement blessé lors de l’attentat dans les locaux de Charlie Hebdo en janvier 2015.
Philippe Lançon a-t-il été un patient particulier ?
Techniquement, non. Nous opérons une vingtaine de traumas balistiques chaque année et les conséquences, dans son cas, n’étaient pas trop graves.
L’étage moyen de la face n’était pas atteint, le patient n’avait pas perdu les yeux.
Ce qui a fait de Lançon un patient particulier, ce sont les circonstances, avec un GIGN qui débarque quasiment dans la salle d’opération, puis des policiers lourdement armés gardant la porte de sa chambre et, enfin, les visites, dont celle du chef de l’État. Et puis, bien sûr, il y a eu son livre.
Philippe Lançon écrit : « Les chirurgiens vivent dans un monde où tout ce qui est techniquement possible finit par être tenté ». Vous confirmez ?
Je crois que, fondamentalement, c’est comme cela qu’on devient chirurgien, sur cette conviction que tout se répare.
Et on le fait parce qu’il va bien falloir sortir le patient de sa situation. Si on tente, c’est pour répondre à un besoin.
Et tant que le patient ne nous dit pas qu’il s’accommode de tel ou tel défaut, nous devons proposer des solutions.

Question : Oui, mais c’est là que cela devient intéressant, car on sent que Lançon, à un moment, en a assez…
Bien sûr, mais on ne peut pas le laisser sans mandibule, il s’agit de sa qualité de vie après le traumatisme. Je n’ai pas le souvenir d’avoir eu à convaincre quiconque du bien-fondé d’une opération. C’est le plus souvent moi qui suis à convaincre !
Je pense à ce patient de 88 ans atteint de Parkinson. Il a subi une mandibulectomie interruptrice voilà quinze ans, qui n’a jamais été reconstruite.
Il porte une prothèse guide et présente donc une latéro-déviation majeure. La prothèse lui a abîmé ses dents restantes et, surtout, elle entretient sur le moignon une zone de dysplasie qui déclenche très régulièrement des petits cancers.
Les odontologistes et moi-même refusions de réaliser une nouvelle prothèse guide. J’ai passé deux mois à essayer de convaincre ce patient que le mieux était l’ennemi du bien.
C’est finalement lui qui m’a convaincue d’opérer.
Lançon s’identifie aux trappistes cloîtrés dans leur monastère. Il dit des médecins que, « comme les moines en Dieu », il croit en eux.
Certes, le patient est entièrement dépendant de son chirurgien et de l’équipe de soin, et il est bien obligé de mettre son sort entre leurs mains.
Mais pourquoi, en réponse à ce propos de Lançon, avez-vous évoqué le syndrome de Stockholm ? Vouliez-vous dire une forme de transfert ?
Un jour, Lançon me dit : « J’ai trouvé le titre de mon bouquin, ça va s’appeler Le lambeau ».
J’éclate de rire, il m’en demande la raison. Il rit alors à son tour quand je lui explique que le nom technique du lambeau est « transfert libre microanotomosé ».
Le transfert, tout le monde connaît ça en psychanalyse. En fait, je ne me suis pas attardée à la lecture détaillée de son livre parce que c’est un peu gênant de se voir ainsi au travers du miroir du regard d’autrui.
Ça laisse une impression bizarre.
Mais si on a une approche de ce livre allant au-delà de cette lecture immédiate, c’est très concrètement la description d’un transfert malade-médecin.
Lançon parle de renaissance. Quelle est la part que prend le médecin dans cette renaissance ?
Le patient victime d’un trauma balistique n’est plus jamais le même. C’est un autre. Qu’il soit hétéro- ou auto-infligé, il y a une telle violence dans ce traumatisme que le patient d’avant est mort et qu’il doit ressusciter.
On dit toujours, de mémoire de chirurgien, qu’un patient qui a fait une tentative de suicide par balle ne tente jamais à nouveau de le faire. Il y a quelque chose de cathartique qui se produit chez eux. Leur ancienne vie et leur visage sont partis avec le coup de feu, et cela donne un nouveau sens à leur vie.
À commencer par retrouver un visage humain, ce qui les occupe terriblement parce que, en effet, il y a du travail.
Lançon a été opéré 17 fois, mais d’autres patients nécessitent 150 interventions voire plus. C’est un work in progress pour le reste de leur vie.
Et quand Lançon dit qu’il est un autre homme, il est évident que ce jour-là, à Charlie Hebdo, Philippe Lançon est mort.
On apprend aussi beaucoup de nos patients. Êtes-vous la même chirurgienne après ce cas ?
Après le cas Lançon, définitivement oui !
Techniquement, nous n’avions pas d’état d’âme. En revanche, lorsque les choses sont extrêmement difficiles, alors oui, on apprend et on change. Je pense à ces moments où je me suis dit « si je continue sur cette voie-là, je vais mettre en danger la vie de ce patient ».
Comment défait-on le lien praticien-patient qui se constitue pour la réussite du traitement et qui, nécessairement, doit ensuite se défaire ?
Il y a en effet un moment où les choses doivent se normaliser. Tous nos patients ont ce parcours, où ils éprouvent des difficultés à rompre le lien. Le chirurgien assure le suivi dans le cadre du contrat qu’il a passé avec son patient.
Et puis les choses deviennent plus simples, plus banales. D’où, chez Lançon, ce ressenti d’abandon.
Le patient doit se rendre compte qu’il n’est plus la priorité. Nous avons été invités, Philippe Lançon et moi-même, à parler devant un auditoire de 200 psychanalystes. Michèle Brun, qui avait été à l’initiative de cette rencontre, a conclu dans ces termes : « En fait, la chirurgie, c’est comme l’analyse. Quand on y est, on y est vraiment, mais quand c’est fini, c’est complètement fini ». J’avais trouvé ça très juste.
Pensez-vous que le médecin prend sur lui le mal du patient, comme cela est dit à un moment ?
Non ! En revanche, je crois que, très fondamentalement, la médecine c’est prendre beaucoup sur soi de l’angoisse du patient. Je n’ai aucun doute sur ce point.
J’ai une formule dont je suis assez fière et qui, je crois, résume assez bien notre métier : « La médecine c’est le choix de l’angoisse et l’angoisse du choix ».
Nous choisissons d’être aux côtés des patients angoissés et, quoi qu’on veuille nous faire croire, ce n’est pas le patient qui décide. C’est nous qui prenons les décisions, et qui prenons sur nous l’angoisse de mal dormir en se demandant si on a fait le bon choix. Cela n’est pas un sacerdoce ou quoi que ce soit de cet ordre. C’est tout simplement le travail. Prendre sur soi l’angoisse existentielle et les décisions, c’est la vérité de mon travail.
Et cela, même si le contexte actuel voudrait que l’on dise au patient : « On vous opère ou on vous fait de la radiothérapie ? Choisissez ! » Non, c’est odieux de penser que l’on irait demander au patient de choisir ou, pire encore, à sa famille, alors même que nous avons des réunions de consensus de deux heures où l’on s’étripe entre confrères.
Le savoir accumulé par le patient, cet alliage entre ses connaissances techniques et son expérience, serait-ce un plus pour le chirurgien que vous êtes ?
Oui. Nous avons essayé d’aider à la constitution d’une association de patients, parce que je suis convaincue que l’expérience des patients nous serait très utile. Cela n’a jamais marché malgré tous mes efforts.
Peut-être parce que cette initiative venait d’en haut, des médecins. Le livre de Lançon aura peut-être cette utilité ?
Propos recueillis par Marc Roché
* Philippe Lançon, Le lambeau, éd. Gallimard, Folio 2020.
Agenda